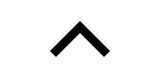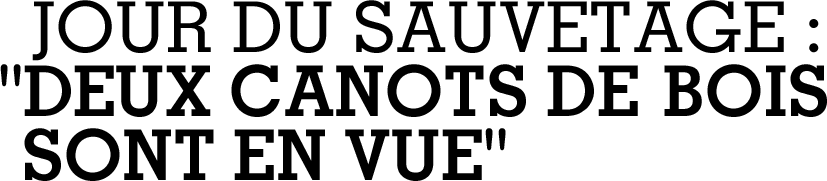© Kenny Karpov pour SOS Méditerranée
la face sombre
de l’île blanche
Je regarde ses pieds, ses chevilles et ses cuisses, si maigres, abîmés par les coups, l’exil, l’eau de mer. Je regarde ses cuisses, et je regarde les miennes. Je me demande s’il arrivera à sortir du canot. Ses jambes vont se briser. Elles ne pourront pas porter son corps, pourtant pas très épais. Je ne connais pas son nom. Il est soudanais, les bruits du moteur qui nous ramène vers l’Aquarius couvrent le son de sa voix. Je n’ai pas mon appareil photo. La présence de garde-côtes libyens dans la zone de sauvetage, à quelques mètres de nous, nous oblige à faire preuve de prudence.
Le Soudanais est prostré, son corps replié entre ses bras. Son short est trempé. Malgré les 30 degrés qui étourdissent nos têtes, il tremble. Un homme passe la main autour de ses épaules. Peut-être son ami, un frère, ou simplement un compagnon d’infortune. Les corps se ressemblent tant sur ces canots de bois. Où allait-il dans cette immensité d’eau ? Pensait-il réellement atteindre une côte européenne sur des planches de bois à peine capables de les mener au-delà des eaux libyennes ? Cela fait des années qu’un canot n’a pas atteint les côtes italiennes. L’Aquarius se rapproche. Machinalement, le navire déroule son échelle, et les sauveteurs tendent leurs mains. Il est 12h30 : le bateau accueille dans ses flancs 92 migrants. Moins de trois heures plus tard, ils seront 187.
J’ai été prévenue à midi. “Deux bateaux de bois sont en vue”, m’a simplement dit Ebe, un des membres de l’équipage, alors que je fumais sur l’un des ponts. “Va te préparer.” Les deux embarcations de fortune sont parties à 5h, ce matin-là. L’heure à laquelle le jour commence à pointer, quand les premiers rayons du soleil éclairent la route, tandis que la nuit finissante soustrait les canots à la vue des gardes-côtes. Ils ont dérivé sept heures avant de croiser l’Aquarius.

On me hisse précipitamment sur un RIB, un des zodiacs du navire humanitaire chargés d’approcher les canots en détresse. Il faut aller très vite : la première embarcation, surchargée, risque de sombrer. Une première équipe de sauveteurs fonce vers la chaloupe. “Nous sommes une ONG, nous sommes là pour vous aider, OK ? Nous ne sommes pas libyens, ne vous inquiétez pas.” Les premiers mots, criés en anglais, en français et en arabe, sont destinés à rassurer. Il ne faut pas qu’ils paniquent, qu’ils tombent à l’eau. La vue des humanitaires peut parfois semer le trouble et entraîner une dangereuse agitation. “Ça va aller, OK ? Nous allons vous emmener en Italie. Restez calmes.”
Ils sont une cinquantaine sur le premier canot en bois. Le regard hagard. Les sauveteurs distribuent des gilets de sauvetage. Puis le ton se durcit : “Vous restez assis, OK ? Si vous vous levez, on arrête tout !” Je n’arrive pas à savoir s’ils comprennent. Ils ne bougent pas. “On va tous vous sortir de là, mais je veux d’abord que vous me disiez s’il y a des enfants et des blessés parmi vous.” Pas de réponse. Personne ne bronche, leur regard ne quitte pas les mains tendues des sauveteurs. Moi, je regarde l’eau. Une curiosité morbide me pousse à chercher des corps autour de nous.

Au loin, on aperçoit un autre canot. Je ne sais pas combien de personnes sont à l’intérieur. Beaucoup trop. Je ne comprends pas comment les passeurs ont fait tenir autant de corps dans un si petit espace. J’apprendrai plus tard que leur moteur a été volé par des hommes armés. Les 41 occupants de l’embarcation ont été abandonnés en pleine mer. Quarante et une personnes condamnées à mort sur un radeau à la dérive.
Il est 16h. Les 187 naufragés sont à bord de l’Aquarius. Tanguy, le sauveteur breton de SOS Méditerranée, saute sur le canot flottant, vidé de ses locataires. Il regarde dans chaque recoin. Il faut vérifier qu’il n’y a pas de corps oubliés. On pense souvent aux noyés, on pense moins aux asphyxiés, ceux qui, dans un mouvement de panique, meurent écrasés sous le poids de leurs voisins d’infortune. Ils sont généralement retrouvés à la fin des sauvetages au fond des cales des bateaux. Une fois l’inspection terminée, le canot est percé puis coulé. Les bateaux ne doivent pas être réutilisés.
Ce jour-là, un seul canot s’abîmera au fond de la mer, deux autres seront brûlés. Dans une sorte de rituel dont eux seuls ont l’explication, les gardes-côtes libyens y ont mis le feu après l’évacuation des rescapés. La présence de ces militaires, hors des eaux libyennes, est assez rare. Les humanitaires, qui se méfient de leur comportement “parfois imprévisibles”, ne communiquent pas avec eux. Nous regardons les épaisses fumées noires monter vers le ciel. Il est 16h30 quand je remonte à mon tour sur le navire humanitaire. J’ai mal au cœur. Trente minutes sur le zodiac des sauveteurs et je suis KO. La houle, les vagues, le soleil. Je ne retrouve pas le Soudanais. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je me souviens de ses jambes, j’ai oublié de regarder son visage.

À bord, je m’attendais à un chaos, il n’en est rien : au milieu des centaines de corps engourdis par l’épuisement du voyage, et des pleurs des enfants, SOS Méditerranée et MSF gèrent, dirigent, réglementent et, surtout, ne transigent jamais. Les règles sont la clé du vivre-ensemble dans cet espace confiné, expliquent-ils. Après distribution des kits (chacun reçoit une couverture, une bouteille d’eau, des vêtements propres), les personnes les plus vulnérables – femmes et mineurs – sont dirigées vers une pièce qui leur est réservée, baptisée le “shelter” ; les hommes sont dirigés à l’arrière du bateau. On sépare les maris des épouses, les sœurs des frères, les pères de leurs enfants. Ils se retrouveront plus tard, dans la soirée, avant de se séparer de nouveau pour la nuit.
Je file vers le shelter où une dizaine de personnes se débarrassent de leurs vêtements trempés. À l’entrée, le photographe de MSF et Mark, de l’équipe médicale, se font gentiment refouler par Elizabeth, la sage-femme. Pour permettre aux femmes de se reposer et se “mettre à l’abri” d’éventuels prédateurs, le shelter ne tolère pas de présence masculine. Moi, je suis un peu gauche. Je donne un pantalon douze ans à un garçon de huit, je ne sais pas où sont rangées les culottes taille six ans, et je distribue un surplus de couvertures polaires alors qu’il fait 40 degrés dans la pièce.
En fait, j’ai promis aux équipes que je poserais mon appareil photo et mon carnet de notes, en temps voulu, pour donner un coup de main, mais je suis rapidement confrontée à ma propre inutilité : je ne suis pas marin, je ne peux pas aider aux manœuvres ; je ne suis pas infirmière, je suis un obstacle sur le chemin de l’équipe médicale qui ne cesse de courir partout ; je ne parle pas l’arabe, je peux à peine communiquer avec la grande majorité des familles. J’ai tenté d’emmener quatre enfants syriens de moins de six ans aux toilettes : un fiasco. Quant aux règles à respecter, je ne suis pas plus fiable : je suis à deux doigts de donner des cigarettes – ce qui est formellement interdit – à deux jeunes hommes qui m’ont vue en train de fumer, ou encore de communiquer le mot de passe wifi – ce qui est tout aussi interdit – à une mère de famille qui voudrait juste envoyer un mail à sa mère restée en Syrie.

Quand l’heure du repas arrive, il est 17h30. Je commence à m’adresser aux rescapés. Ils sont syriens, bangladais, soudanais, marocains, nigérians, togolais, nigériens. Leurs histoires ont souvent la même trame : l’enfer libyen, les coups des miliciens, les balles reçues dans le corps, les tortures, et la montée sur des canots de caoutchouc ou de bois, à peine étanches, lancés sur la mer par des passeurs peu scrupuleux. Certains récits dépassent l’entendement : on entend parler de marchés aux esclaves, de migrants abattus sans raison d’une balle dans la tête.
Très vite, on se surprend à ne plus interroger nos interlocuteurs. On les réconforte, on essaie de trouver quelques mots rassurants. Je croise le regard d’Albara, un mineur soudanais d’une quinzaine d’années, assis sur un banc à l’arrière du bateau. Il ne pleure pas, il ne se plaint pas, mais il ne raconte rien. À la simple évocation du mot Libye, Albara prend sa tête entre ses mains et la secoue de longues secondes. Quand je me suis approchée la première fois, il m’a pris la main et l’a gardée dans la sienne. Je n’ai pas voulu l’interviewer. Je le regardais et je l’ai imaginé se noyant au milieu de la Méditerranée. Combien de garçons, comme lui, ont disparu sans même être répertoriés ? Je lui ai simplement dit que, maintenant, tout allait s’arranger. Il m’a répondu “Non” puis est parti se coucher.